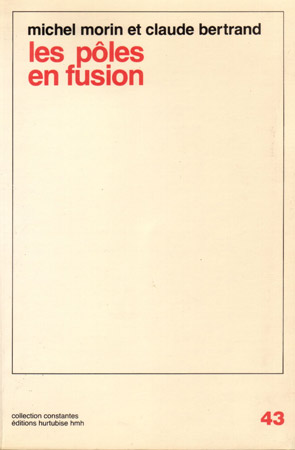
Les pôles en fusion
(écrit en collaboration avec Claude Bertrand)
Montréal, HMH, coll. « Constantes », 1983, 231 p.
Résumé
Ce livre de Michel Morin et Claude Bertrand joue sur les frontières, ou peut-être plus justement les dissout-il, passant incessamment du travail réflexif au récit. Est-ce là un récit ponctué de micro-traités ou alors un livre de philosophie qui s’ébauche à même les rêves, les fantasmes, les rencontres, les amitiés et les déplacements dans l’espace ? Nul n’est besoin de trancher ici puisque les « pôles » sont en fusion, l’un passant dans l’autre : le Nord et le Sud, le chaud et le froid, la lumière du concept et l’obscurité du corps, l’Europe et l’Amérique.
Co-créateurs, Bertrand et Morin ont divisé leur livre en deux parties intitulées « L’un » et « L’autre ». Dans leur livre précédent, Morin et Bertrand avaient produit le concept du « territoire imaginaire de la culture ». Avec Les pôles en fusion, ils viennent en quelque sorte habiter, chacun à sa manière, ce territoire imaginaire de la culture en marquant cette idée générale du sceau de leur corps propre, de leur intimité et de leur fantasmagorie respective.
Le problème fondamental de « L’un » est qu’il manque de forme. C’est un rêveur et un petit animal immergé dans son corps et ses pensées. Voilà pourquoi il a besoin de Hegel et de l’amitié de son ami Oeil-de-Vent pour extraire les pensées de son corps qui autrement y resteraient enfermées. Mais abstraire l’idée du corps, c’est apprendre du même mouvement à reconnaître le corps dans sa pure phénoménalité, s’enfoncer plus que jamais en lui après s’en être abstrait ! Enfanté par l’esprit, par l’Oeil-de-l’esprit, ce petit animal pensant, qui se nomme « Fantasio » dans le récit, enfantera à son tour sa créature chérie, « Colombine », qui n’est femme que d’être restée au fond d’elle-même une petite fille... Mais attention ! Ce rêveur, « Fantasio », est aussi un guerrier : il sait lancer des grains de sable dans les yeux des autres, — ce sont ses petites vérités qu’il nous lance ainsi…
« L’autre », quant à lui, est un être de prime abord plus abstrait : il sait manier les mots, jongler avec les idées, peupler son territoire imaginaire de la culture de multiples références et réminiscences. La « parole libre », écrira-t-il, est de nulle part et « glisse sur le dos des continents ». Aussi voyageons-nous beaucoup dans cette seconde partie, du Canada à la Californie en passant par le Mexique et le Maroc. « L’autre », disions-nous, a la parole facile, mais il a mal au ventre, quand sa tête s’échauffe, son corps frissonne. Tel Méphistophélès, « L’autre » est à la recherche d’un corps où son esprit pourrait s’incarner : il cherche son Faust. Dans les dernières pages de cette section, « L’autre » pensera ce corps qui a froid mais qui ne peut se résoudre à aller chercher la chaleur qui lui manque dans le ventre d’une femme, chaleur qui lui rappelle trop d’où il vient et pas assez où il va.
Ces réflexions sur le corps de « L’un » et de « L’autre » ne sont pas là pour imposer un quelconque modèle, bien au contraire ! Chaque corps est unique, et si ce livre a une vertu, c’est de mettre chacun sur le chemin qui le mènera à penser son propre corps, chose que la conscience répugne à faire, elle qui préfère se complaire dans les généralités.
Retour en haut de page ![]()
Extraits
« Comme tu as de belles petites oreilles, Colombine » : les autres, bien sûr, ne comprendront rien à ce langage. Les autres ? Des images d’hommes, des images de femmes, des images d’enfants : une vision sociale, trop réelle, de l’univers. Un faux réel. J’ai tout abandonné pour te parler à l’oreille, dans le creux de ton oreille si petite. Vois-tu, cette nuit, encore une fois, je n’ai pas dormi. Je suis resté les yeux ouverts, les bras et les jambes étendus, comme si on y avait introduit des barres de fer. Les yeux ouverts, toute la nuit. J’ai respiré, respiré longtemps l’odeur de la nuit, les restes de la maladie. C’est le temps qui en moi a fait son œuvre : l’œuvre de la maladie est l’œuvre du temps. Mais il ne faut pas craindre l’angoisse, ni le dépaysement, ni la peur de tout perdre : se laisser aller plutôt à la profondeur de la terre, atteindre les racines de l’être. C’est notre secret, tu le sais, alors ne le dis pas. Du fond de cette nuit, là-bas, au loin, tu vois cette lumière, cet éclair à l’horizon : l’Œil du Temps, l’Œil du vent. Il est là, comme l’Œil qui pénètre la terre, la rend translucide, transparente à elle-même. […] Tu n’as pas à craindre le soleil, puisque je suis aussi ce soleil. Non, tu n’es plus la pluie. La pluie, c’était seulement lorsque nous étions tristes, encore orphelins. La pluie n’est plus. Maintenant, la nuit s’achève. Ce fut une belle nuit, une belle maladie. Comme une métamorphose. Il ne faut rien regretter. Les autres, qui ne comprendront peut-être rien à cette histoire, découvriront un jour quelque chose en elle, quelque chose qui est aussi en eux : l’autre versant de leur existence sociale, c’est-à-dire leur existence solitaire, leur existence la plus intime. La langue fondamentale ne dit rien d’autre, la langue fondamentale écrite le redit avec plus d’insistance encore. L’existence intime apparaît. La langue fondamentale dit l’apparition de l’existence intime. (p. 23-24)
Le général : Le peuple vient de nous assurer qu’il ne répondrait à aucune convocation. Il est occupé pour longtemps, paraît-il.
Des voix : Il est occupé pour tout le temps… !
Le général : Pour tout le temps ! Le peuple nous a avisé de son absence définitive.
Le grenadier : Le peuple est donc mort ?
Le général : En quelque sorte. Quant à moi, en tant que général de réserve, j’ai la tâche ingrate mais exaltante d’annoncer que le peuple ne sera pas au rendez-vous.
Des voix : Pas au rendez-vous, pas au rendez-vous… !
Le général : Mesdames, messieurs (quinte de toux, éclaircissements de voix), mesdames, messieurs…
Le grenadier : Mais à qui parlez-vous, mon général ? Il n’y a personne.
Le général : Eh bien ! je parle, je parle… À ceux qui veulent bien m’entendre.
Dans le coin de la scène, à gauche, Pierre et Louis, se tenant par la main, chantent, chantent :
« Le peuple a mal au ventre, mal au ventre, le peuple reste à la maison, à la maison. »
Le général : Mesdames, messieurs, l’Histoire arrive aujourd’hui à un tournant. Le moment est solennel. Car le peuple nous a fait part de son absence définitive. (p. 128)
Mon corps est d’abord un corps de parole, de verbe, de mots. Présent à sa parole, comme le corps de Mohammed est présent au soleil, à la mer, au jeu. Mon corps est innocent dans sa parole, le corps de Mohammed est innocent dans sa chaleur solaire. Quand je parle, souvent je tremble et je frissonne, comme si j’avais froid, mais ma tête s’échauffe, mes yeux brûlent, je peux même pleurer, lorsque je parle. Je pleure sur ce qui me fait mal, et ce qui me fait mal, c’est cette chaleur que je n’ai plus dans la poitrine, dans le cœur, les bras, les jambes. Dans mes yeux, il y a beaucoup de tristesse et de nostalgie. J’aimerais être né ailleurs, être un autre, avoir au ventre la chaleur de Mohammed, sa poitrine ample et ferme, et chaude, et jusqu’à ses cheveux rudes et crépus. Mes cheveux plus souples et plus longs tombent quelque peu sur mon coup, mais ils sont là pour le vent, et le vent ne suffit pas à les réchauffer. Seule la main de Mohammed le peut. (p. 197)
Retour en haut de page ![]()
Critiques
« Les lecteurs pressés ont ignoré que Le Territoire imaginaire de la culture fait partie d’une recherche plus vaste de Morin et Bertrand. La lecture de l’ensemble de leurs travaux nous indique d’abord une pensée en mouvement et non un système clos sur quelques hypothèses en forme de conclusions ; on y constate aussi que leur recherche philosophique se développe à même un questionnement existentiel aussi risqué qu’exigeant. Lire Le Contrat d'inversion(1977), L’Amérique du Nord et la culture (1982), Les Pôles en fusion (1983). »
Wilfrid Lemoine, Liberté, octobre 1986.
Retour en haut de page ![]()
